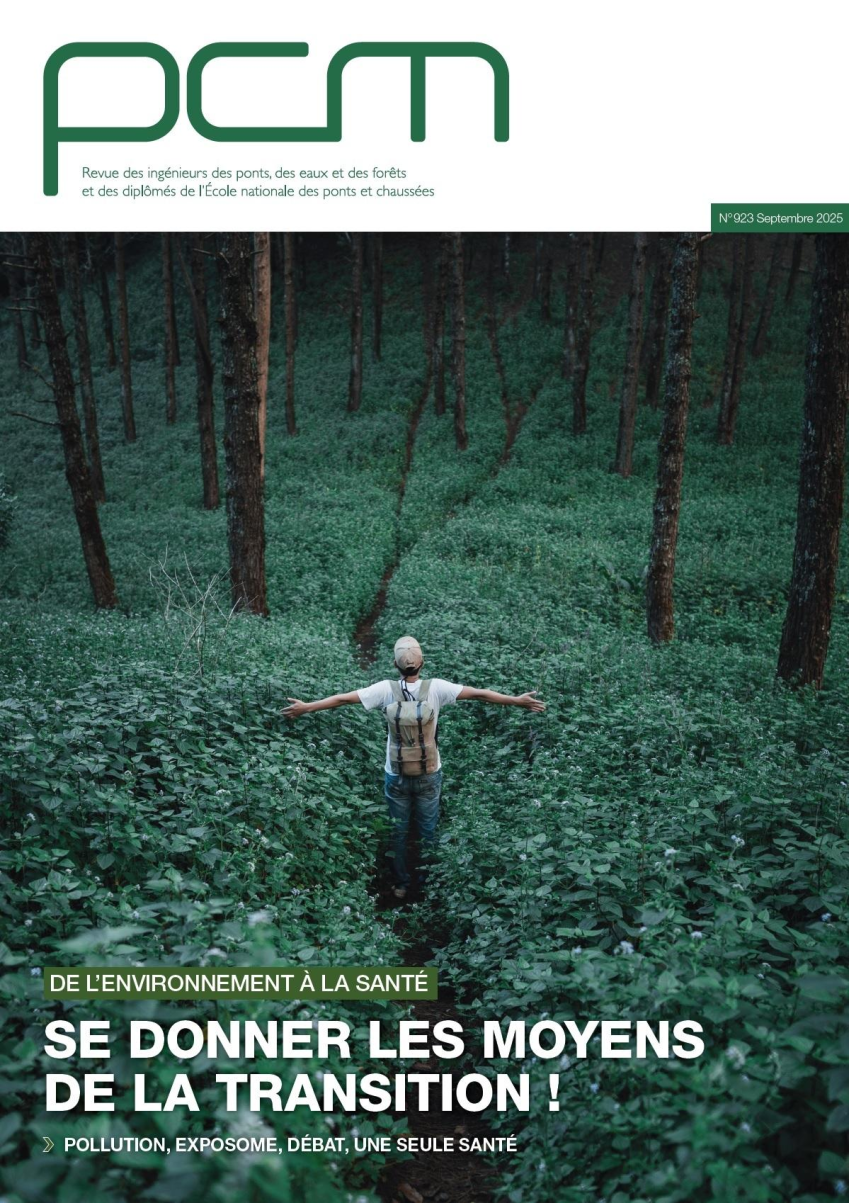
Editorial

Eric Vindimian, IGPEF honoraire à l'Igedd
Depuis plusieurs décennies des chercheurs en sciences de l’environnement, en santé publique, en épidémiologie, ou toxicologie, explorent les relations entre les modifications de l’environnement et la santé humaine. Des alertes émises auprès des décideurs, publics et privés, ont souvent conclu leurs travaux : la dégradation de l’environnement, d’origine humaine, est une source importante de stress, de maladies ou même de mortalité dans la population. Des mesures ont été prises, notamment en termes de réduction de la pollution industrielle, de normes d’émissions des véhicules ou de qualité des milieux. Mais elles sont souvent des compromis entre le respect de limites d’exposition réellement saines et le souci de ne pas trop contraindre les activités économiques, et donc les pollutions qu’elles engendrent.
Aujourd’hui, il n’est pas de semaine, voire de jour, sans que les médias se fassent l’écho de pollutions toxiques, de résultats épidémiologiques inquiétants ou de polémiques mettant en cause une forme d’inaction publique. L’accroissement gigantesque du nombre de substances d’origine anthropique présentes dans tous les milieux, l’augmentation des cas de cancers, chez les jeunes notamment, les problèmes d’infertilité croissante dans les pays industrialisés, et bien d’autres risques sanitaires, ont de quoi inquiéter tous ceux qui se préoccupent de santé publique. Des études ont parfois calculé leurs coûts, et, bien qu’approximatives, elles révèlent une charge importante et croissante en termes de dépense publique et de perte de compétitivité des entreprises. C’est ainsi que le dossier santé-environnement est aujourd’hui au cœur de nombreuses polémiques.
Les acteurs qui se font face arguent d’un côté de la catastrophe sanitaire qui se profile avec l’augmentation très importante des maladies non transmissibles, dont la cause serait environnementale. Les sceptiques implorent les pouvoirs publics de moins réguler, de protéger des secteurs économiques victimes de normes trop sévères qui nuisent à leur performance dans la compétition mondiale. Le dénialisme prolifère, alimenté par ceux qui ne croient pas, ou ne veulent pas croire, les résultats scientifiques, ainsi que par des groupes industriels qui construisent l’ignorance en diffusant des fausses nouvelles, parfois portées par des chercheurs corrompus.
Ce numéro fait le point sur plusieurs aspects importants des relations entre l’environnement et la santé. On y découvre de nouvelles notions comme le concept d’exposome ou celui d’Une seule santé (« One Health »). On constate des pollutions généralisées, comme celles aux substances per et poly-fluorées, les désormais fameux PFAS. On montre que des phénomènes physiques, comme la lumière, ont également un impact sur la santé. On verra aussi comment les citoyens prennent des initiatives pour objectiver les questions qui les touchent, comment les agences sanitaires dialoguent avec le public afin de réaliser des expertises qui répondent à leurs préoccupations. On débat ensuite de principes comme la séparation entre expertise et décision. Et on se tournera enfin vers la nature, dont la biodiversité déclinante est liée aux atteintes à la santé publique, et qui est aussi source d’inspiration pour trouver des solutions qui préservent la vie sur Terre, notre santé et notre bien-être.
La question du compromis est peut-être celle qui, en toute bonne foi, nous enferme quand nous concevons des politiques publiques. Nous sommes pris dans un mode de décision qui accroît les risques sanitaires et la dépense publique tout en nourrissant le sentiment de mal-être de la population, sans pour autant dégager les performances économiques espérées. Beaucoup d’observateurs de la vie politique s’accordent sur la nécessité d’une transition vers un monde plus respectueux de l’environnement et de la santé. Cela implique des changements profonds que nous sommes pourtant encore réticents à opérer. En nous tenant au milieu du gué, en essayant de ne pas trop accroître les impacts tout en ne désespérant pas les acteurs économiques traditionnels, nous ne nous donnons pas les moyens de cette transition. Nous créons une défiance sociale et des frustrations, voire du désespoir, chez ceux qui luttent pour une meilleure santé publique, mais aussi chez les acteurs d’une nouvelle économie plus frugale, qui peinent à trouver leur marché face à l’économie du gaspillage des ressources.
Ce numéro est loin de traiter la vaste question des relations entre l’environnement et la santé humaine. On peut espérer simplement de ce premier tour d’horizon qu’il stimulera la motivation des jeunes générations à s’impliquer dans les sciences de l’environnement ou de la santé publique et dans la conception de politiques publiques protectrices de la santé des êtres humains et de la biodiversité.
 04-05-edito-pcm923.pdf
04-05-edito-pcm923.pdf





Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.