Facteurs environnementaux
L'exposome
L'analyse des liens complexes entre environnement et santé prend désormais en compte une multitude de facteurs, réunis dans le concept d'exposome. C'est l'ensemble des expositions qu'il englobe qui doivent déterminer les politiques de santé publique de demain.
L’exposome a été défini en 2005 par l’épidémiologiste Christopher Wild, directeur du Centre international de recherche sur le cancer[i] comme « la totalité des expositions à des facteurs environnementaux que subit un organisme humain de sa conception à sa fin de vie en passant par le développement in utero, complétant l'effet du génome ». Plus tard, pour Miller et al. en 2014[ii], il s’agit de la « mesure cumulative des influences environnementales et des réponses biologiques associées tout au long de la vie, y compris les expositions de l'environnement, du régime alimentaire, du comportement et des processus endogènes ». Dans cette définition, le caractère cumulatif masque les variations, mais elle précise, ce que Wild n’avait pas exclu, que des facteurs comportementaux, alimentaires et endogènes (l’exposome interne) doivent être considérés. Par ailleurs, pour Miller et d’autres chercheurs européens et américains, l’exposome recouvre non seulement la caractérisation des expositions mais aussi de leurs impacts biologiques[iii].
Un groupe de travail de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a proposé la définition suivante : « L’exposome correspond à la totalité des expositions néfastes comme bénéfiques à des agents chimiques, biologiques, et physiques, en interaction avec le statut physiologique, le milieu de vie et le contexte psycho-social, que connaît un organisme vivant de sa conception jusqu’à la fin de sa vie afin d’expliquer son état de santé. » On retrouve dans cette définition les expositions à des facteurs sociaux, mais ils semblent exclus de l’exposome strict pour interagir avec lui comme des covariables. En réalité, la situation est plus complexe, parce que si certains stress psycho-sociaux font bien partie de l’ensemble des expositions, les conditions sociales comme les inégalités sont en réalité des déterminants de l’exposome puisqu’elles conditionnent la qualité de l’environnement, l’alimentation etc.
L'intégration de facteurs multiples
Ces définitions issues du monde de la santé humaine se distinguent dans leur questionnement sur la part de l’inné et de l’acquis dans l’explication des pathologies. Elles ne se contredisent pas, même si le caractère implicite, explicite ou interactif des expositions à un environnement social, culturel et économique interrogent. Il semble acquis que l'exposome a une vocation universelle et intégratrice, tout ce qui peut constituer un facteur explicatif de la santé humaine, hors fond génétique, a vocation à être pris en compte. Ainsi, par exemple, des psychiatres utilisent le terme d’exposome digital pour expliciter les relations entre l’exposition aux réseaux sociaux et la santé mentale des jeunes[iv].

La pollution atmosphérique en milieu urbain est une composante essentielle de l’exposome (source : © CAHKT I iStock)
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a prôné l’approche des déterminants sociaux de la santé, concept proposé par Whitehead et al.[v] en 1991, en reconnaissant que : « les chances des individus d’être en bonne santé sont étroitement liées aux conditions dans lesquelles ils grandissent, s’instruisent, vivent, travaillent et vieillissent ». Ces conditions diffèrent selon les groupes sociaux et sont constitutives d’inégalités : « différences évitables et injustes entre groupes de personnes ou communautés en ce qui concerne leur état de santé », ces inégalités « freinent le développement humain et entravent le développement économique et social des communautés, mais également des pays ». Ces arguments ont été récemment développés par les groupes de Delpierre et Kelly-Irving[vi]. Plus récemment, un rapport de l’OMS explore les déterminants commerciaux de la santé, désignés comme les « conditions, actions et omissions des acteurs commerciaux qui affectent la santé ». La revue The Lancet a lancé une série spéciale sur ce sujet[vii], dont l’éditorial affirme que « quatre industries (tabac, alimentation malsaine, combustibles fossiles et alcool) sont responsables d'au moins un tiers des décès par an à l'échelle mondiale ».
Une approche expérimentale de l'exposome
Sur le plan opérationnel, l’exposome et ses différentes variantes posent de redoutables problèmes méthodologiques. Ainsi, prendre en compte l’ensemble des expositions d’une personne ou d’un groupe, par exemple attaché à un territoire, implique une connaissance exhaustive de ces expositions. Connaître les effets conjoints de deux agents dangereux dont l’effet croît proportionnellement ou linéairement avec le niveau d’exposition implique la mise en place d’un plan d’expérience croisant au moins deux niveaux de chacun des agents. Si la courbe qui relie l’effet à l’exposition est quadratique ou non linéaire il faut alors croiser plusieurs niveaux d’exposition de chacun des agents avec chaque niveau de l’autre. On mesure facilement la complexité d’expériences qui s’intéresseraient à trois, quatre dangers ou plus, cela devient rapidement hors d’atteinte. On s’en tient en général à une approche additive des effets, considérant que les facteurs de danger agissent indépendamment les uns des autres. Cependant, l’approche d’addition des doses gagne du terrain notamment au niveau réglementaire.

L’eau douce est un milieu important d’exposition à la pollution. (© D-Keine I iStock)
L’évaluation des risques des substances chimiques toxiques, pour celles qui ne sont pas cancérigènes, consiste à définir un seuil en dessous duquel aucune toxicité n’est attendue. La régulation de la présence de ces substances est fondée sur le fait de s’assurer que, substance par substance, ce seuil n’est jamais dépassé. Ce dogme du seuil d’effet ne résiste pas à la vision exhaustive de l’exposome, une simple expérience de pensée permet de s’en convaincre : supposons deux substances identiques, ou au moins d’effet similaire ; comment imaginer qu’une personne exposée simultanément aux deux substances, chacune légèrement en dessous du seuil de toxicité, ne serait pas en danger car, de fait, elle est exposée à presque deux fois le seuil – si l’on admet l’addition des doses. L’exposome ne peut donc se concevoir que sur le fondement de modèle d’effets continus, et sans seuil toxicologique.
Les limitations de l’approche expérimentale de l’exposome, évoquées ci-dessus, peuvent cependant être franchies en utilisant des outils de biologie et de chimie analytique à haut débit. Les techniques de biologie moléculaire actuelles permettent de mesurer un grand nombre d’effets biologiques sur l’expression des gènes et le métabolisme des organismes exposés à des agents dangereux. De nombreux progrès sont attendus en toxicologie moléculaire, d’autant qu’on connaît de mieux en mieux les mécanismes qui relient exposition et effet. Par ailleurs la spectrométrie de masse permet aujourd’hui de détecter des centaines voire des milliers de substances dans des matrices biologiques comme le sang et les urines[viii]. Le développement de capteurs portables permet quant à lui une meilleure caractérisation des expositions. Ces progrès sont d’autant plus nécessaires que la production de substances chimiques explose dans le monde. Persson et al.[ix] suggèrent que la quantité des nouveaux produits chimiques émis dans l’environnement à l’échelle planétaire dépasse la capacité de la planète à les absorber.
Une prise en compte holistique de la santé
En épidémiologie, des efforts importants ont été consentis pour suivre de grandes cohortes de personnes volontaires, en couplant observations et mesures de l’environnement et de la santé à plusieurs étapes de la vie. Des relations significatives entre paramètres d’exposition et santé des populations ont ainsi pu être établies, comme pr exemple la mise en évidence par Rebouillat et al. [x] du lien entre l’exposition alimentaire aux pesticides et le diabète de type 2 et les études montrant le lien entre pollution atmosphérique et cancers du sein[xi] ou des poumons[xii]. Nul doute que l’émergence rapide des outils d’intelligence artificielle et de gestion des grands jeux de données ouvrent la possibilité d’ajouter de nouveaux liens entre expositions et santé.
Aux nombreuses expositions à des agents physiques, chimiques et biologiques s’ajoutent des déterminants socio-économiques. Ainsi l’explosion de la pauvreté en France, rapportée en 2024 par l’Observatoire national des inégalités, constitue un inquiétant facteur social de mauvaise santé en partie lié à une plus grande vulnérabilité aux expositions néfastes.
La notion d’exposome est donc vaste et englobe l’ensemble des facteurs pouvant affecter la santé humaine. Cela lui confère une universalité intéressante sur le plan conceptuel et une opérationnalité en matière d’appui aux politiques publiques, lesquelles ne peuvent plus ignorer l’univers des facteurs environnementaux, comportementaux, sociaux et économiques susceptibles de porter atteinte à la santé humaine. Cette notion apparaît proscrire une approche sectorielle des facteurs de risques pour ouvrir l’action publique à une prise en compte holistique de la santé publique.
Santé publique France a développé un outil intéressant qui relie les connaissances sur l’exposome aux actions des pouvoirs publics. Intitulé « Évaluation quantitative d’impact sanitaire », il s’appuie sur des relations établies par des études épidémiologiques entre la santé des populations concernées et des facteurs d’exposition quantifiés comme la chaleur, la proximité d’espaces verts, la possibilité de mobilité active (marche et vélo) la pollution de l’air ou le bruit. Des applications pilotes sur trois agglomérations - Lille, Rouen et Montpellier - ont montré aux décideurs les gains en santé qu’ils pouvaient obtenir en fonction des paramètres de leurs politiques d’aménagement. Ces gains peuvent aussi être traduits en termes économiques. Si cet outil était généralisé à l’évaluation environnementale de tous les plans locaux d’urbanismes, nul doute que de grands progrès de santé publique pourraient advenir dans les prochaines années.

L’exposome est l’ensemble des facteurs environnementaux auxquels nous sommes exposés de la naissance à la mort et qui vient compléter les effets de notre génome. © Just-super I iStock
En conclusion, face à la complexité du monde et aux innombrables nuisances auxquelles les humains sont exposés, une approche éthique devrait interroger systématiquement l'exposome dans toutes les décisions susceptibles d’impacts sur la santé humaine. Lutter contre toutes les formes d’exposition à des agents dangereux, d’inégalités économiques et sociales impactant la santé, de dégradation de l’environnement, serait une manière de contribuer à l’émergence d’une économie du bien-être, volet sanitaire de l’économie positive recommandée par le groupe de réflexion présidé par Jacques Attali en 2013.
Références
[i] Wild C.P. Complementing the Genome with an “Exposome”: The Outstanding Challenge of Environmental Exposure Measurement in Molecular Epidemiology. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev., 2005 14 (8): 1847–1850
[ii] Miller GW, Jones DP. The nature of nurture: refining the definition of the exposome. Toxicol Sci., 2014 Jan;137(1):1-2. doi: 10.1093/toxsci/kft251. Epub 2013 Nov 9. PMID: 24213143; PMCID: PMC3871934.
[iii] Barouki R et al. The Exposome and Toxicology: A Win-Win Collaboration. Toxicol Sci., 2022 Feb 28;186(1):1-11.
[iv] Pagliaccio D. et al. Probing the digital exposome: associations of social media use patterns with youth mental health. NPP Digit Psychiatry Neurosci., 2024:2:5
[v] Whitehead, M., Dahlgren G. What can we do about inequalities in health. The lancet, 1991, n° 338 : p. 1059–1063
[vi] Neufcourt L et al. Assessing How Social Exposures Are Integrated in Exposome Research: A Scoping Review. Environmental Health Perspectives, 2022 Nov;130(11):116001.
[vii] EDITORIAL. Unravelling the commercial determinants of health. The Lancet, 2023, Vol. 401, Issue 10383, p1131.
[viii] David A. et al. Towards a comprehensive characterisation of the human internal chemical exposome: Challenges and perspectives. Environ Int., 2021 Nov;156:106630
[ix] Persson L. et al. Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel Entities. Environ. Sci. Technol., 2022, 56, 1510-1521
[x]Rebouillat P. et al. 2022. Prospective association between dietary pesticide exposure profiles and type 2 diabetes risk in the NutriNet-Santé cohort. Environ Health, 2022 May 25;21(1):57
[xi]Gabet S. et al. Breast Cancer Risk in Association with Atmospheric Pollution Exposure:A Meta-Analysis of Effect Estimates Followed by a Health Impact Assessment. Environmental Health Perspectives, 2021, 129, 1289.
[xii] Hill, W., Lim, E.L., Weeden, C.E. et al. Lung adenocarcinoma promotion by air pollutants. Nature 616, 159–167, 2023. https://doi.org/10.1038/s41586-023-05874-3
 06-09-barouki-pcm923.pdf
06-09-barouki-pcm923.pdf




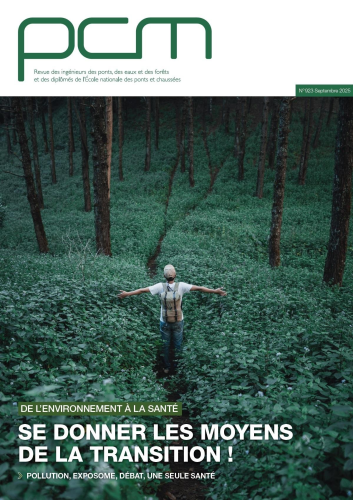

Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.